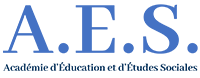Par Jean-François Lambert, Maître de conférences honoraires en Neurosciences à l’Université Paris 8
« L’homme occidental n’a pu se constituer à ses propres yeux comme objet de science […] qu’en référence à sa propre destruction […] » (Michel Foucault). Aurait-on jamais dû parler de sciences humaines sinon de Science Humaine ? Notre réflexion se devra de préciser d’abord les enjeux et les limites de ce qu’il convient d’appeler « science » et d’envisager ensuite ce qui peut être considéré comme spécifiquement humain. Certains proclament la fin de « l’exception humaine » (Jean-Marie Schaeffer), d’autres envisagent la « création » d’un « homme augmenté » (courant dit transhumaniste), d’autres encore osent affirmer qu’un cochon adulte est davantage une personne qu’un nouveau-né humain (Peter Singer), qu’en est-il vraiment ? Assiste-t-on à l’accomplissement ultime du réductionnisme physicaliste à l’œuvre principalement dans les sciences de la vie et de « l’esprit » ? A partir d’une relecture critique du paradigme des (neuro)sciences cognitives nous tenterons de montrer que « quelque chose » résiste à la réduction (échappe au formalisme) de sorte que tout discours scientifique raisonnable se devrait de prendre en compte sa propre incomplétude et donc de reconnaître que la science n’a pas l’exclusivité du savoir sur l’homme et qu’elle ne rend pas caduque la question du Sens.
Lire l'article complet
Jean-Paul Guitton :
En venant ici, je suis passé devant un grand bâtiment sur lequel j’ai pu lire « Maison des sciences de l’homme ». Et je me suis dit : je ne sais si l’on peut parler de sciences humaines, mais elles ont leur maison et même leur fondation. Et je me suis demandé s’il ne fallait chercher une signification au fait que cette « Maison des sciences de l’homme » ait pris la place d’une prison.
Pour nous aider à savoir si l’homme, si les hommes peuvent (encore) être objets de science, nous avons demandé à Jean-François Lambert de nous proposer sa réponse. Qui est Jean-François Lambert ? C’est ce que je vais essayer de vous dire en quelques mots, en essayant de ne pas me tromper, car il a plusieurs homonymes que l’on rencontre sur Internet, et même plusieurs Jean-François Lambert portent la barbe.
Le nôtre est professeur de psychophysiologie à l’Université Paris-Saint-Denis, ou plus précisément maître de conférences en neurosciences à l’Université Paris 8 (Saint-Denis), directeur-adjoint de l’Institut d’enseignement à distance de l’Université Paris 8, membre du Conseil d’administration de l’Université Paris 8, président de l’Université Interdisciplinaire de Paris.
Ses thèmes de recherche portent sur les interactions environnement, sommeil et mémoire, émotion et dépression, les corrélats neurobiologiques de l’imagerie mentale, l’épistémologie des neurosciences. J.-F. Lambert est un scientifique : il participe d’ailleurs activement aux activités de l’Association des scientifiques chrétiens.
Son parcours personnel, sans doute marqué par la révolution de mai-68, l’a conduit des patronages d’Ivry-sur-Seine à la carrière d’universitaire distingué qu’il est aujourd’hui, avec un passage par Amnesty International dont il a présidé un temps la Section française.
Scientifique et philosophe, il juge essentiel le » paradigme de l’incomplétude » qui, dès les années trente, annonce dans la plupart des disciplines l’avènement d’une nouvelle science ouverte à l’indicible.
« De la sphère des sciences cognitives et des neurosciences, où j’agis, dit-il, ma vision positive est que les recherches, notamment sur la « vie artificielle », vont contraindre l’homme à reconnaître sa vraie nature, son « noyau dur » : il est autre chose qu’une machine.
Ma vision négative est la même, mais à l’envers : dès lors que nous nous apercevrons que les robots produisent mieux que nous, la tentation sera grande -¬ et elle l’est déjà -¬ de dire que décidément l’homme n’est qu’une machine minable, une sorte de chaînon entre l’animal et le stade machinique parfait, et qu’il peut désormais disparaître. Cela dit, 80 % des hommes sur Terre ne sont pas préoccupés par ce genre de question, mais par celle de savoir s’ils auront à manger. Cette réalité est une fantastique menace, mais peut aussi devenir l’élastique qui nous ramènera aux vraies réalités. »
Jean-François Lambert s’exprime avec humour sur sa propre « incomplétude » lorsqu’il constate qu’il ne peut pas grand chose pour contribuer à la santé du monde : « Je repense parfois à cette phrase d’un humoriste anglais : Quand on peut, on fait : quand on ne peut pas, on enseigne. »
Son rêve secret : « Que ma vision positive soit vraie et que l’homme découvre sa vocation. Dans ma tradition, ce rêve prend la figure du ressuscité, je n’en vois pas d’autre. »
Ses films préférés sont Le Dictateur et Les Temps modernes. Et s’il écoute de la musique, c’est beaucoup de Bach, pas mal de grégorien et l’intégrale de Piaf.
« L’homme occidental n’a pu se constituer à ses propres yeux comme objet de science […] qu’en référence à sa propre destruction […] » (Michel Foucault).
Jean-François Lambert :
Peut-on parler de sciences humaines sinon de Science Humaine ?
Avant 1968, au sein de l’Université, les Facultés de Lettres étaient devenues des Facultés de Lettres ET Sciences Humaines. Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche parle de Sciences Humaines ET Sociales (SHS). Le vocable « sciences humaines » fait donc bien partie du vocabulaire académique et recouvre des disciplines et des cursus universitaires clairement identifiés avec leurs spécialistes, leurs sociétés savantes, leurs revues, leurs colloques. Mais que recouvre ici le terme de « science » et pourquoi avoir voulu appliquer aux savoirs en question les mêmes critères de validation que ceux admis pour les sciences de la nature ?
Ce choix n’est pas innocent du point de vue anthropologique car en faisant de l’Homme un « objet » de science comme un autre, il abolit toute idée d’exception humaine et ouvre la voie au réductionnisme physicaliste. Plus largement, il convient de s’interroger sur la place prise par la science dans la modernité et sur les rapports que cette science entretient avec les autres formes de savoir et de sagesse. La science est fondamentalement une activité humaine et en ce sens il ne peut y avoir de science qu’humaine. Pourtant le développement des sciences expérimentales conduit aujourd’hui à une remise en cause radicale du statut de l’humain dans la nature et à une banalisation complète de l’espèce. Notre réflexion se doit donc de préciser d’abord les enjeux et les limites de ce qu’il convient d’appeler « science ». Nous centrerons ensuite notre réflexion sur le paradigme des sciences cognitives qui représente actuellement, dans les sciences humaines, la tentative la plus aboutie de naturalisation de l’esprit humain et l’une des remises en cause les plus radicales de ce qui était classiquement considéré comme spécifiquement humain.
Il convient d’abord de rappeler que la science classique (dont procèdent les sciences humaines en général et la psychologie en particulier) s’est imposée en Occident aux dépens d’une triple mise en question de la position singulière de l’homme dans la nature. Au décentrage cosmologique de la révolution copernicienne a succédé le décentrage biologique et phylétique du darwinisme puis le décentrage psychologique de l’inconscient. Freud, on le sait, parle à ce propos d’une triple humiliation infligée par la science à l’orgueil et au narcissisme humains. Il existe, en effet, un lien étroit – et certainement pas suffisamment souligné – entre la notion d’inconscient et la conception darwinienne de l’évolution qui ont ensemble contribué à disqualifier l’idée d’une nature humaine irréductible à ses conditionnements biologiques En fait, cette volonté de banalisation de l’espèce humaine s’inscrit dans un processus plus vaste de contestation de l’ethnocentrisme inhérent à la conception chrétienne de la nature comme création, conception qui accorde à la conscience humaine un statut privilégié et introduit une discontinuité dans l’évolution. Cette notion de discontinuité fondatrice justifie par ailleurs les distinctions classiquement admises entre homme et animal, nature et culture, homme et femme, normal et pathologique. Or, ce sont bien toutes ces distinctions qui sont aujourd’hui contestée et cette contestation trouve dans le darwinisme et l’inconscient ses principaux arguments.
La singularité humaine contestée
Mais dès lors que l’on radicalise cette notion de continuité chère au darwinisme et que l’on refuse toute idée de rupture ontique entre l’animal et l’homme, il n’est plus absurde d’affirmer, comme le fait le philosophe américain Peter Singer, qu’« un chimpanzé ou un cochon, par exemple, se rapproche bien plus du modèle d’être autonome et rationnel qu’un nouveau-né ». Pour l’anthropologue Svante Paablo, de l’Institut Max Planck à Leipzig, «
Il ne fait aucun doute que la vision génomique de notre place dans la nature va être à la fois une source d’humilité et un coup sérieux porté à l’idée du caractère unique du genre humain ». Mais dès lors que le caractère unique du genre humain est mis en question, le même Peter Singer ne vois plus aucune raison d’accorder un droit de vie spécial à un embryon ou à un nouveau-né : « Tuer un nouveau-né ( ) n’est pas équivalent, du point de vue moral, à tuer une personne ». Comme il situe le passage de l’état de nouveau-né à celui de personne vers la fin du premier mois post-natal, il ne craint pas d’affirmer finalement qu’un mois lui semble donc « un délai raisonnable à accorder aux parents pour décider si leur bébé doit continuer à vivre » (La Recherche, octobre 2000).
La singularité humaine n’est pas seulement contestée au sein du monde animal mais également désormais « en aval » au sein de ses productions. Si l’on en croit le neurocybernéticien espagnol R. de Gopegui « L’avenir qui attend l’homme est celui de garçon de courses des robots du futur ». Un certain Ray Kurzweil, touche-à-tout de l’informatique avancée, affirmait, il y a peu, que l’ordinateur aura rattrappé son propriétaire vers 2020. « Dix ans plus tard – ajoutait-il – l’équivalent électronique du cerveau humain se vendra sur le marché pour un dollar ( ) D’un point de vue scientifique, aucune barrière n’existe qui empêchera de réaliser un jour une copie électronique parfaite du cerveau ( ) Bientôt nous allons rencontrer des créatures électroniques qui affirmeront être conscientes ( ). Nous finirons par reconnaître une personnalité à ces machines bien plus humaines que n’importe quel animal ». Selon Jean-Paul Baquiast (auteur d’un ouvrage intitulé « Pour un matérialisme fort ») « Il faut admettre que le monde décrit par les nouvelles sciences est tout autant un monde sans l’homme qu’un monde sans dieux ». Pour que puissent émerger d’autres formes d’intelligence, de conscience et de corporéité « il faudra faire descendre l’homme du piédestal où continuent de le mettre les conservateurs… ».
D’autres voient déjà dans l’interfaçage direct du cerveau et de l’ordinateur, le moyen de fabriquer un « homme augmenté ». Pour les uns se sera un guerrier capable d’entendre le moindre son à des kilomètres, de voir la nuit, de percevoir les rayons infrarouges ou ultraviolets et de piloter n’importe quel appareil en le brancher directement sur son système (neuro)informatique.
La connaissance scientifique : une méthode et un discours
Pour juger de la pertinence de tels propos assénés par des scientifiques reconnus et faire la part de ce qui relève de l’opinion des chercheurs en question et non de leur science, il convient d’abord de s’accorder sur une définition de « la science ». Il est classique d’admettre que c’est une connaissance objective qui établit entre les phénomènes des rapports universels et nécessaires autorisant la prédiction de résultats (effets) dont on est capable de maîtriser expérimentalement ou de dégager par l’observation, la cause. Elle est un mode de production d’énoncés dits « bien formés » car soumis à des règles rigoureuses parmi lesquelles : l’argumentation rationnelle, le respect d’un formalisme (recours à la logique), l’objectivité (recours à des tests empiriques), l’universalité, la reproductibilité, la causalité, le déterminisme. Ces règles s’appliquent – en principe – indépendamment de l’objet étudié.
Si donc il paraît légitime de distinguer les sciences humaines des sciences de la nature, ce n’est pas d’abord du fait du mode de production des connaissances mais bien davantage du fait de la nature de l’objet à connaître.
La distinction des deux types de science ne se comprend, en effet, que dans la mesure où l’humain n’est pas immédiatement réductible à la nature autrement dit dans la mesure où la « nature » de l’homme dépasse l’ordre naturel des choses. Mais alors comment rendre compte scientifiquement de ce « sur-naturel » qui, par définition, échappe à la science. La science prétend à l’objectivité : sa démarche est un procès (ou process) en objectivation. Les tremblements de terre ne sont pas des grondements de Zeus mais s’expliquent mécaniquement par la tectonique des plaques. Les arcs-en-ciel ne sont plus considérés comme des messages divins mais s’expliquent par la réfraction de la lumière sur des gouttelettes d’eau. Ce procès n’a posé à l’humain aucun problème tant qu’il s’agissait d’objectiver des mécanismes physiologiques comme la fonction glycogénique du foie mais la question de sa légitimité s’est posée dès lors que l’on a prétendu en étendre le champ au domaine de la conscience et de la subjectivité. En effet, si la subjectivité existe, elle ne saurait – par définition – être réduite à ses corrélats objectifs.
Or, dans la mesure où la science ne traite (également par définition) que de faits objectifs (ou pour le moins objectivables) on peut douter qu’il puisse vraiment exister une science de la subjectivité et plus généralement de ce qui fait l’homme humain. La citation de Foucault prend ici tout son sens : l’homme ne devient objet de science qu’en consentant au sacrifice de sa propre subjectivité. On peut alors vraiment douter qu’il puisse jamais exister une science (au sens des sciences de la nature) du fait humain.
La réduction dont parle Foucault est aujourd’hui particulièrement à l’œuvre dans les sciences cognitives qui visent explicitement à la naturalisation de l’esprit. Nous consacrerons donc dans la suite un important développement à cette approche cognitive de l’humain enfin d’en montrer les limites. On peut ici souligner avec un certain étonnement que beaucoup de physiciens admettent – voire revendiquent – l’existence d’une forme de conscience irréductible aux processus décrits par la physique alors que, dans le même temps, beaucoup de biologistes et de psychologues s’enferment dans un réductionnisme physicaliste plus ou moins radical. La psychologie « humaniste » est de plus en plus concurrencée par les neurosciences, elles-mêmes interprétées dans un cadre exclusivement naturaliste et physicaliste. Comme le disait Maurice Clavel des « chrétiens-marxistes » d’après 68 : « De peur des les derniers chrétiens, ils seront les derniers marxistes », on peut dire des réductionnistes physicalistes que : « De peur d’être les derniers humanistes, ils seront les derniers matérialistes ».
Il peut être utile de souligner ici que la connaissance scientifique n’épuise pas toute forme de savoir. Il convient de reconnaître la valeur de la doxa comme forme légitime de connaissance, même si celle-ci ne répond pas, comme nous le verrons, à tous les critères de l’épistémè. Quant au logos, il désigne le fondement de la sagesse dont aucun savoir ne peut faire l’économie et qu’aucune « science » ne saurait épuiser.
La connaissance scientifique se définit en partie par sa méthode, la méthode scientifique qui ne se réduit pas à la méthode expérimentale qu’elle implique cependant naturellement. Elle s’articule [la méthode scientifique] autour de trois pôles interdépendants : l’observation (collecte des données), l’interprétation (recherche de régularités, formalisation, établissement de lois, création de modèles, élaboration de théories) et la déduction prédictive devant permettre l’élaboration de tests expérimentaux.
Le discours scientifique, quant à lui, est caractérisé par l’importance particulière qu’il accorde à la logique et aux mathématiques et par une mise en œuvre originale de la fonction argumentative du langage qui prend ici la forme d’une véritable « exigence critique ». Cette exigence critique s’exprime d’abord sous la forme d’une mise en question radicale des évidences immédiates de la perception et de l’opinion. La science prétend en effet substituer aux préjugés et aux habitudes mentales un savoir médiatisé, critiqué. Cette première forme de l’exigence critique met entre parenthèses l’expérience naturelle (subjective) qu’elle « réduit » à des données contrôlables (objectives).
Le physicien belge Jean Bricmont parle d’une fonction disqualifiante de la science vis-à-vis de toute une série de « savoirs ». Selon lui, le discours scientifique se présente sous deux aspects : un aspect positif (un ensemble d’assertions sur le monde) et un aspect sceptique consistant à douter de toutes les autres assertions faites sur le monde en dehors de la science ! Bricmont refuse le compromis rationnel et ce qu’il appelle « le renoncement ascétique » à dire la vérité sur le monde (la science ne devant répondre qu’au comment et non au pourquoi des choses).
Réduction et objectivité
La « réduction » est, en effet, inhérente à la démarche même de la science mais elle peut prendre deux formes très différentes : la réduction éliminative (on élimine par exemple le mental en le réduisant au neuronal) ou la réduction dite causale qui n’élimine pas son objet (par exemple la faim) en lui trouvant une explication physiologique (l’activation de certaines aires de l’hypothalamus). La distinction entre ces deux formes de réduction est un préalable nécessaire à toute critique du « réductionnisme » qui ne vise, en principe, que sa forme « éliminativiste ».
L’objectivité est également considérée comme un critère majeur de scientificité. Il convient, là encore, d’en distinguer deux formes : l’objectivité épistémique correspondant à un énoncé vrai indépendamment des observateurs (Charles de Gaulle est l’auteur de l’Appel du 18 juin 1940) et l’objectivité ontologique qui peut être associée à une réalité objective indépendante (comme une éclipse de lune) ou à une réalité subjective dépendante (comme une émotion). La science vise à l’objectivité épistémique, c’est-à-dire à la constitution d’un ensemble d’énoncés vrais indépendamment de nos préjugés. Cependant, l’objectivité épistémique de la méthode n’implique pas nécessairement l’objectivité ontologique des objets (des entités) auxquels elle s’applique.
L’objectivité renvoie à la notion de fait. On peut définir le fait comme ce qui est donné, ce qui advient (« un état de chose », selon Wittgenstein ou « ce qui est le cas »). Le fait est considéré comme l’atome constitutif de la connaissance scientifique. Le réel, c’est l’ensemble des faits. Un fait scientifique doit pouvoir être exprimé dans un formalisme en principe mathématisable. Il n’existe donc pas de fait à l’état brut mais seulement énoncé dans un langage. Enoncer un fait c’est déjà l’interpréter car un fait n’arrive jamais seul : il est toujours chargé de théorie préalable (d’a priori non scientifiques, voir ci-après). Ainsi, une proposition ne reflète pas simplement un état de chose, elle l’interprète. Le fait et l’interprétation (le langage ou la théorie à l’intérieur desquels il peut être énoncé) sont indissociables. La connaissance scientifique n’échappe donc pas à l’herméneutique : c’est l’interprétation qui actualise le fait en puissance. Le fait observé émerge du potentiel à travers le filtre de l’interprétation (Popper utilise l’image du filet dont la maille détermine la nature de la prise). C’est pourquoi la méthode expérimentale, par elle-même, n’enfante rien : elle ne développe que les idées qu’on lui soumet. Comme le défend Claude Bernard, l’idée c’est la graine et la méthode c’est le sol qui lui fournit les conditions pour se développer. Le fait ne s’impose donc pas de lui-même à la raison, c’est au contraire le raisonnement qui établit le fait, et un raisonnement suppose un agent cognitif capable de raisonner.
Science et scientisme
Contrairement à ce qu’affirme le positivisme radical, la science ne peut ignorer les questions métaphysiques notamment celles relatives aux conditions mêmes de constitution du discours scientifique. L’objectivation implique, en effet, des conditions subjectives que le scientisme feint d’oublier. Les succès de la science sont ainsi tributaires d’une réduction de la réalité à ses seuls aspects réputés objectifs et le scientisme consiste précisément à nier ce qui a été mis entre parenthèses. Une telle occultation de l’opération de clôture constitutive du champ du savoir scientifique entraîne la fermeture sur soi de l’exigence critique de la science. Cette « amnésie des conditions initiales » conduit inévitablement au discrédit de toute autre forme de connaissance (que la connaissance « scientifique »), au refus de toute inhérence, au déracinement de l’homme, à la rupture entre l’ordre des valeurs et l’ordre des faits. Pourtant il n’y a pas de donation a priori de la méthode scientifique mais des conditions subjectives de l’objectivité. La science ne peut administrer la démonstration de ses propres convictions. Ainsi le discrédit de l’esprit et du sens véhiculé par beaucoup de scientifiques repose sur une extension illégitime du paradigme de la science expérimentale à des domaines de la réalité dont elle s’est a priori interdit l’accès. En outre, les contraintes imposées à la connaissance par la méthode scientifique sont telles qu’on ne saurait aujourd’hui réduire le Réel à une description prétendument objective de la réalité empirique.
Un autre type d’erreur, tout aussi fatale, consiste à oublier que les parenthèses sont nécessaires et à réintroduire subrepticement dans le discours scientifique des considérations que l’exigence critique conduit justement à mettre entre parenthèses. Prétendre montrer où et comment l’esprit interagit avec le cerveau procède d’un paralogisme de même nature que celui qui consiste à en nier l’existence parce qu’il appartient à un domaine de la réalité dont la science s’est a priori interdit l’accès. Certes, les neurosciences se doivent de mettre entre parenthèses l’existence de la subjectivité pour ne concentrer leur effort que sur l’objectivité des mécanismes cérébraux et des comportements auxquels ils sont associés. Mais quand on prétend ensuite rendre compte de cette subjectivité que l’on a d’abord écartée du champ de son investigation – en postulant son identité aux mécanismes objectifs – on transgresse les limites de la science. L’application au domaine de l’esprit des principes qui ont fait le succès des sciences expérimentales débouche sur une difficulté majeure liée à ces principes mêmes. A partir du moment où l’on ne s’adresse qu’aux phénomènes observables – en l’occurrence aux manifestations de l’activité mentale – la façon de procéder détermine très exactement le résultat. Mais qu’en est-il alors de ce qu’on néglige ?
La meilleure attitude en ces domaines ne reste-t-elle pas celle de Popper quand il déclare, à propos de la métaphysique, que « il serait ridicule d’interdire de parler de quelque chose parce que ça ne fait pas partie de la science […]. En vérité – poursuit-il – nous pouvons dire beaucoup de choses qui ne relèvent pas de la science, et il faut que nous le puissions, seulement il ne faut pas que nous les fassions passer pour scientifiques ». Il insiste sur le fait que « ceux qui ne s’y intéressent pas [à la métaphysique] n’ont qu’à s’écarter, un point c’est tout. Il n’est pas besoin de prononcer des interdictions ».
Expliquer et comprendre
L’historien allemand Droysen opposait la méthode dite « explicative » propre aux « sciences de la nature » et la méthode appelée « compréhensive » qui distinguerait les « sciences de l’esprit ». De même, pour Wittgenstein, l’explication par les causes ne concerne que l’explication scientifique et il convient de reconnaître d’autres formes d’explication telle que l’explication esthétique qui est une forme d’explication par les raisons. L’explication par les raisons s’oppose à l’explication scientifique par les causes car il s’agit, en fait, non plus d’explication mais de compréhension. Or, comme le soutient Freud, le but de la science n’est pas de com-prendre (de donner une vision globale rassurante du réel) mais d’ex-pliquer (de « réduire » ce réel indifférent au narcissisme humain).
Expliquer, en effet, c’est « déployer » ou plus précisément « déplier » (explicare) autrement dit « enlever les plis », mettre à plat, réduire. Comprendre (comprehendere) c’est, au contraire, « saisir » (prendre ensemble). Expliquer c’est rechercher des causes, comprendre c’est trouver des raisons. Expliquer causalement les symptômes de la dépression en termes de troubles du métabolisme de la sérotonine (par exemple) ne permet pas de comprendre le vécu du patient qui attend davantage de la psychothérapie des raisons de vivre que des explications physiologiques de ses symptômes. La science cherche à expliquer ce qui ne peut qu’échapper à sa compréhension, la religion permet de comprendre ce qu’il ne lui appartient pas d’expliquer. Jacques Monod « explique » la vie, Michel Henry cherche à la « comprendre ». Expliquer, c’est ramener des faits singuliers à des lois générales alors que comprendre consiste à saisir, en quelque sorte de l’intérieur, par « sympathie », un fait signifiant dans sa singularité. C’est bien autour de cette distinction entre expliquer et comprendre que peut s’envisager une complémentarité des sciences de la nature et des sciences humaines.
Neuroscience et singularité humaine
Qu’en est-il alors de la singularité humaine qui justifierait une approche scientifique spécifique ? L’homme a souvent été défini par la station debout, la main, l’outil, la parole ou son esprit religieux. Selon le Professeur Jean Bernard : « L’homme est le seul animal vivant de l’équateur au pôle, le seul animal dont l’épouse se farde, le seul animal qui se souvient de son grand-père. C’est surtout le seul animal qui ait conscience de sa propre mort [ ] » L’homme est le seul animal qui pense qu’il n’est pas [seulement] un animal. Pour de nombreux anthropologues et paléontologues contemporains, la spécificité de l’homme réside précisément dans l’affranchissement des déterminismes naturels dont procède le comportement animal. On assiste effectivement à un découplage très net entre l’évolution, somme toute réduite, du patrimoine génétique humain et celle, considérable, de ses conduites et de son psychisme. Au niveau des schèmes fonctionnels assurant les grandes régulations comportementales, rien ne permet de singulariser davantage le cerveau humain. Comme l’écrit Sir J. Eccles, « C’est une mesure de notre ignorance que l’on n’ait pu identifier dans le néocortex aucune structure particulière ni aucune propriété physiologique par quoi le cerveau humain se distinguerait nettement du cerveau d’un singe anthropoïde. L’extraordinaire différence dans les performances est difficile à attribuer à une simple multiplication par trois des modules [ ] ». Ce n’est donc pas dans l’empirique objectivable qu’il convient de chercher l’irréductible différence avec l’animal mais dans le fait que seul de tous les vivants, l’homme est capable de donner un nom aux êtres et aux choses, de donner un sens à ce qui est, de revendiquer des valeurs. En clair, de telles capacités sont celles généralement reconnues à un esprit tel que l’entendent les philosophes : ce qui a de la volonté, des projets, une mémoire, une conscience. Or, pour un matérialiste conséquent, la matière c’est ce qui n’a pas d’esprit, c’est-à-dire qui ne possède aucune de ces qualités que nous venons de reconnaître comme caractéristiques de l’humain.
Le paradigme des sciences cognitives
Comme nous l’avons indiqué, nous allons maintenant centrer notre réflexion sur l’impact des sciences cognitives sur l’idée que l’on se fait de la spécificité humaine. Les Sciences Cognitives (SC) constituent la tentative la plus récente – et certainement la plus accomplie – de naturalisation de l’esprit. Cela se traduit par le fait qu’elles abordent la pensée et la connaissance comme des phénomènes dont l’étude relève des sciences de la nature de type physico-mathématique. Ce programme scientifique est révolutionnaire dans la mesure où, depuis Descartes, l’esprit était considéré comme non mathématisable, donc non mécanisable.
Si les SC ont pu voir le jour, c’est précisément parce qu’il est progressivement devenu possible de mécaniser la pensée. Cela se fit en plusieurs étapes : il a fallu, d’une part, réduire la pensée à un calcul et, d’autre part, réduire le calcul a un mécanisme. La première étape (réduction de la pensée au calcul) a été franchie depuis longtemps puisque Leibniz pensait « avoir conçu un élégant artifice en vertu duquel certaines relations peuvent être représentées et désignées de manière numérique » et pour Hobbes « le raisonnement n’est rien d’autre qu’un calcul ». Pour l’un et l’autre la pensée se ramène bien à un processus calculatoire. Cette réduction est une constante de la rationalité occidentale dont on trouve déjà la trace chez Platon. La seconde étape n’a été franchie que récemment avec l’invention de la machine de Turing (formulation théorique de l’ordinateur) qui a permis de définir mathématiquement la notion de calcul comme un processus mécanique fini abstrait. La découverte d’une telle notion mathématique rendait donc possible en pratique le projet de naturalisation de l’esprit, pour peu que l’on accepte d’identifier ce dernier au calcul. L’approche symbolique ou computationnelle postule, en effet, l’existence d’un langage représentationnel et assimile les processus cognitifs aux opérations d’une machine de Turing.
L’émergence du paradigme des sciences cognitives a heureusement mis un terme – relatif – à la « longue nuit behavioriste » (M. Bunge). Pour l’essentiel, les SC se fondent sur la prise en compte du fait que, contrairement au paradigme behavioriste , les comportements et les processus mentaux ne se réduisent pas à l’enchaînement réflexe de stimulus et de réponses, mais qu’il y a lieu de reconnaître entre les deux une médiation. Une telle médiation se traduit non seulement par l’existence d’un délai entre les entrées sensorielles et la réponse motrice mais également par un certain jeu, une certaine incertitude, dans le couplage sensori-moteur permettant la réintroduction des concepts d’image mentale ou d’intentionnalité qui étaient proscrits par le behaviorisme. Ce délai correspond à un processus susceptible d’une double description : en tant que processus physico-chimique, d’une part, et en tant que processus formel, informationnel, cognitif, d’autre part. La question de la pertinence de ce double niveau de description, et celle de la plus ou moins grande subordination de l’un à l’autre, constituent le principal enjeu épistémologique des sciences cognitives. L’approche symbolique ou computationnelle postule l’existence d’un langage représentationnel et assimile, nous l’avons dit, les processus cognitifs aux opérations d’une machine de Turing (machine formelle idéale susceptible de simuler le fonctionnement de n’importe quelle machine réelle). Dans cette perspective le niveau formel est relativement indépendant du substrat qui n’impose que des contraintes limitées (dualité matériel/logiciel).
Le modèle computo-symbolique
Selon la thèse cognitiviste standard, la conscience est une conséquence de la manipulation réglée de symboles. Le terme de symbole utilisé dans le modèle computationnel ne doit pas faire illusion. Il est utilisé ici en un sens purement technique, désignant une chaîne de caractères assimilée à un signifiant dont il reste à préciser qui fournit le signifié. Quelle est précisément la nature de l’opération permettant de passer d’une chose à son symbole ? Un symbole symbolise quelque chose pour quelqu’un. Les règles de correspondance sont fournies, de l’extérieur, par le programmeur où quelque administrateur central. Le système n’apprend jamais que parce qu’il dispose d’éléments premiers qu’il a bien fallu lui fournir, d’où une position volontiers innéiste (ou nativiste) selon laquelle ces éléments sont donnés « à la naissance » du système. Ces éléments premiers définissent une clôture sémantique que rien ne permet d’élargir. En outre, le système doit disposer au départ d’un langage formel lui permettant de traiter les données symboliques. L’analogie avec l’ordinateur montre, certes, comment il est possible de simuler des processus sémantiques par des processus formels, mais elle ne permet pas de comprendre comment le sens vient aux symboles. Nous sommes ici en présence d’un mécanisme formel, issu du positivisme logique, qui transpose en fait au niveau du mental, par le biais du formel, le réductionnisme behavioriste ou physicaliste.
Comme le rappelle justement J. Searle « La syntaxe [ ] n’est pas intrinsèque à la physique du système ; elle est dans l’œil de l’observateur [ ] le calcul n’est pas un processus intrinsèque qui se trouverait dans la nature comme la digestion ou la photosynthèse ; il n’existe que relativement à un agent qui donne une interprétation computationnelle à la physique. Il en résulte que le calcul n’est pas intrinsèque à la nature mais relatif à l’observateur ou à l’utilisateur ». Il s’ensuit donc que ce dernier ne saurait être lui-même réduit à un calcul. De plus, comme le souligne Wittgenstein, un tel calcul suppose d’être effectué : « Le langage ne se réduit pas à un calcul, au sens d’une manipulation de symboles, sans considération de leur signification. En nous servant du langage nous devons faire quelque chose de la même manière que pour calculer il ne suffit pas de regarder les signes : c’est à nous de faire le calcul ».
La reconnaissance (par le paradigme cognitiviste) d’un processus de médiation entre le stimulus et la réponse ne doit donc pas faire illusion car, si le sujet est bien réintroduit comme agent causal c’est seulement en tant que Système de Traitement de l’Information. Il ne s’agit que d’un sujet formel, d’un sujet sans véritable subjectivité. En fait, la psychologie cognitive prolonge le behaviorisme dans la voie du réductionnisme.
Le modèle connexionniste ou neuromimétique
La plupart des neurobiologistes, parmi lesquels Edelman et Changeux, réfutent le modèle computationnel du fonctionnement cognitif qu’ils trouvent encore trop « cartésien » (dualiste). Pour Changeux la métaphore de la machine de Turing est fondée sur une vision mécaniste erronée du fonctionnement cérébral. Dans le cerveau, défend-il, matériel et logiciel sont tout aussi inséparables que le sont structure et fonction. Ici le programme ne se distingue pas de l’organisation structurale (de la connectivité) du réseau. De ce fait, Changeux réfute la thèse de l’indépendance des symboles vis-à-vis de leur support et conteste l’identification, chère à beaucoup de cognitivistes, d’une fonction biologique à un algorithme mathématique. Une telle vision mathématisée du mental constitue pour le célèbre neurobiologiste une forme de réductionnisme tout aussi contestable que le réductionnisme physicaliste. Pourtant on ne peut nier que, d’un certain point de vue (à un certain niveau d’analyse), l’on puisse faire (partiellement ?) abstraction de la nature du support. Le débat à propos de la métaphore de la machine de Turing ne concerne d’ailleurs pas seulement la pertinence de la séparation entre matériel et logiciel (et leur éventuelle indépendance) mais également celle de l’opposition et/ou complémentarité entre processus continus et processus discrets. En fait c’est le statut de la simulation qui est ici en question : simuler (adéquatement) une fonction biologique par un algorithme mathématique ne signifie pas que cette fonction s’identifie à cet algorithme.
Ce n’est pas parce qu’on peut mécaniser une règle que celle-ci est « mécanique ». Toute règle peut être considérée comme la description d’un mécanisme. Les machines de Turing ne sont rien d’autres que des hommes qui calculent. Mais la question de savoir si une machine pense ne peut recevoir aucune réponse tout simplement parce que c’est une question logiquement absurde. La pensée (qui ne réduit pas à la pensée formelle) est bien autre chose que le fait de suivre un ensemble de règles. On peut, certes, produire des résultats qui découlent d’un ensemble de règles et qui donnent l’impression d’une « pensée » mais cela ne prouve pas qu’une pensée ait été produite par ledit ensemble de règles. La pensée est en amont, dans la production des règles dont l’implémentation donnera l’impression d’une pensée qui n’est rien d’autre que la restitution de celle dont le producteur à fait crédit au système. Il faut qu’un être humain se tienne à côté de la machine pour interpréter ses schémas comme une description de quelque chose. En fait, comme nous y reviendrons, si le monde est réductible à un calcul, il est ultimement inaccessible car cette inaccessibilité est la condition même de sa calculabilité.
L’approche connexionniste ou neuromimétique considère, contrairement à l’approche computationnelle, que le raisonnement en termes de symboles est totalement inadapté à la problématique esprit-cerveau. Le neuro-calcul privilégie fortement la nature du substrat (réseau de neurones) et sa structure fonctionnelle (connectivité, poids synaptique…). Le recours aux modèles connexionnistes met en évidence une caractéristique essentielle du cerveau humain : la plasticité de sa structure dont l’organisation est susceptible d’être modifiée par le résultat des opérations qu’elle exécute. On peut simuler cette propriété à l’aide d’un réseau d’automates dont la connectivité (la force des liaisons entre éléments ou poids synaptique) se modifie pas à pas en fonction de l’écart mesuré entre le résultat attendu et le résultat effectif grâce à des propriétés de « rétropropagation ». Le traitement s’opère ici à un niveau sub-symbolique. Ces dispositifs sont très efficaces dans la reconnaissance des formes y compris les formes linguistiques (par exemple la conjugaison des verbes) ou les objets mathématiques.
Dans tous les cas le système n’interprète pas lui-même les symboles ou les configurations qu’il manipule, ce sont le concepteur et, plus tard, l’utilisateur, tous deux extérieurs au système, qui projettent sur ces symboles ou configurations une interprétation. On, voit donc difficilement comment on pourrait accorder à un système informatique une intentionnalité intrinsèque. Son intentionnalité apparaît comme une intentionnalité d’emprunt, dérivée de celle du concepteur et de l’utilisateur qui lui font « crédit de sens ». La « puce » ou le réseau neuronal est (in)formé(e) « pour » s’auto-organiser. La question qui ne manque pas alors de ce poser : « par qui ». Pour ce qui en est de la puce nous connaissons « l’informateur » mais pour ce qui concerne les neurones, certaines réponses laissent perplexes. Ainsi, pour Damasio le cerveau « est préparé par l’évolution », il a été « conçu par l’évolution pour nous aider à gérer notre corps ».
L’idéologie cognitiviste trouve dans le connexionnisme matière à justifier sa tentation de ramener l’explication de l’univers à un système auto-suffisant dont le principe rationnel unique gouvernerait le niveau cognitif aussi bien que le niveau matériel et leurs interactions mutuelles. Une telle explication justifierait le présupposé de ceux qui la soutiennent, c’est-à-dire que l’homme n’est qu’un objet de la nature comme un autre.
Les limites du cognitivisme
On sait, par exemple, qu’il existe une organisation hautement spécifique du traitement de l’information visuelle. Les différentes caractéristiques de l’objet sont traitées en parallèle par des canaux distincts (couleur, forme, mouvement, position, contraste…). Or le sujet qui perçoit, celui pour qui cette activation fait sens (signifie une couleur), n’est réductible ni à des aires du cortex visuel, ni à aucune autre région du cerveau susceptible de les scruter car ce sont des couleurs (des objets) dans le monde et non des représentations dans le cerveau que nous percevons. Le cerveau ignore tout des stimulus qu’il reçoit. C’est moi qui perçoit et qui pense et non mon cerveau ! Ainsi la vision n’est localisée ni dans la rétine, ni dans le nerf optique, ni dans les corps genouillés, ni dans aucune aire corticale : le cerveau ne voit pas. Rien ne voit ni ne pense dans le cerveau
Toujours à propos du système visuel, S. Zeky note que « manifestement il y a plus dans la vision que dans l’œil ». Celui qui voit n’est « manifestement » pas réductible à une subdivision neuro-anatomique. Il en va de même pour la mémoire. Selon F. Crick par exemple « notre cerveau contient une représentation inactive de la tour Eiffel et quand nous pensons à ce monument, la représentation est activée parce que les neurones appropriés déchargent » mais ce ne sont évidemment pas les « neurones appropriés » qui perçoivent l’évocation de la tour Eiffel. Il existe bien d’autres exemples illustrant l’impossibilité sémantique absolue de rendre compte de quoi que ce soit en matière de perception, de mémoire, d’affects, de cognition ou d’action sans avoir recours à quelque pronom personnel désignant un sujet agissant et conscient.
Information et signification
La question de l’interprétation (signification) des configurations ne peut recevoir de réponse non contradictoire à l’intérieur du paradigme cognitiviste. Ce que l’on appelle concept ne fait que renvoyer soit à une série d’états pris par des composants d’une machine électronique ou nerveuse et interprétés comme tel, soit à un énoncé de toute façon produit à l’origine par un humain. Dans les deux cas l’acte de signifier n’est toujours pas expliqué. Le problème récurrent est bien de savoir comment le cerveau engendre les configurations mentales que nous appelons « images » à partir de configurations neuronales (c’est le problème dit des qualia) et comment parallèlement le cerveau engendre aussi un sentiment de soi dans l’acte de connaître. Une présence qui me signifie moi en tant qu’observateur des choses en images. Présence de soi dans une relation particulière à l’objet. S’il n’y avait pas une telle présence comment nos pensées pourraient-elles nous appartenir ?
Comme l’admet Damasio, l’accès aux images sous leur forme consciente n’est possible « qu’à partir du point de vue de la première personne » alors qu’au contraire « les configurations neuronales ne sont accessibles que du point de vue d’une tierce personne. Si j’avais l’occasion, grâce à une technologie de pointe de contempler mes propres configurations neuronales ce serait toujours du point de vue de la troisième personne ». Le compte-rendu réductionniste, en troisième personne, des convictions et des attitudes en général, ne vaut en fin de parcours que pour quelqu’un qui assume en première personne les convictions et attitudes présupposées par le réductionnisme.
Le cognitivisme ne propose aucune explication de ce qu’est l’expérience consciente. Comment le cerveau-esprit computationnel produit-il ou s’articule-t-il avec de l’esprit phénoménologique ? Comment des opérations cognitives élémentaires inconscientes peuvent-elles être éprouvées non pas comme telles mais comme un état signifiant du soi conscient ? En fait, le cognitivisme ne propose aucune explication de ce qu’est l’expérience consciente. Selon le cognitiviste Jackendoff, les éléments de la conscience sont le résultat causal projeté des processus computationnels. (La conscience résulterait de la projection de l’information structurée à des niveaux de représentation intermédiaires, voire relativement périphériques au sein des modules). Mais que veut dire « projeté » ? Ici le cognitivisme a besoin de l’évidence phénoménologique. Or, cela ne va pas de soi car il n’est pas du tout certain que quelque chose soit comme nous l’éprouvons.
Comme le souligne le neurophysiologiste américain B. Libet, « même une connaissance complète de la représentation neuronale ne saurait, sans être validée par le témoignage du sujet, nous dire quelle sensation est en train d’être subjectivement vécue ». A. Damasio reconnait également qu’ « Il est faux de penser qu’on puisse effectivement comprendre la nature des expériences subjectives en étudiant leurs corrélats comportementaux [ ] Vous ne voyez pas ce que je vois quand vous examinez mon activité cérébrale ; vous voyez une partie de mon activité cérébrale au moment où je vois ce que je vois [ ] Je n’ai pas besoin de savoir quoi que ce soit sur le comportement des neurones et des molécules des différentes parties de mon cerveau pour faire l’expérience de la baie de San Francisco ».
Mais précisément, comment passe-t-on de la configuration neuronale de la baie de San Francisco à l’expérience subjective de l’image mentale associée à cette configuration ? C’est la notion même de représentation (symbolique ou non) qui est ici en cause et qu’il convient de discuter.
Configuration neuronale et représentation
Même si l’on admet (comme les physicalistes) que l’expérience consciente est un processus cérébral, il n’y a aucune raison de croire qu’avoir une expérience ressemble de quelque façon à en observer l’occurrence dans son propre cerveau. Il y a là deux modes d’accès irréductibles à un même processus physique se déroulant dans le réseau neuronal.
Quand je vois un stimulus, je ne vois pas une configuration neuronale de mon cortex occipital. Il a été constaté, par exemple, une homologie de forme entre un stimulus visuel géométrique et la configuration d’activité de l’aire visuelle primaire (V1) du cortex cérébral chez le macaque exposé à ce stimulus (couche 4B de l’aire 17). Certes, pour un observateur extérieur, il s’agit bien d’une représentation du stimulus externe mais qu’en est-il pour le singe ? Ce dernier ne « regarde » certainement pas l’image formée sur son cortex visuel.
En tant qu’observateurs nous pouvons comparer le stimulus à la configuration d’activation corticale et considérer que cette dernière est bien une image du premier dont nous pouvons former une image mentale mais nous ne saurions considérer l’image corticale observée par nous sur le cortex du singe comme une image mentale du singe même si on peut raisonnablement supposer que l’animal d’expérience peut le voir aussi comme une image mentale. Dans cette structure neurale, nous autres observateurs pouvons voir une correspondance entre la forme du stimulus et sa représentation sur le cortex du singe mais, lorsque nous voyons le stimulus nous ne regardons pas son image dans notre propre cerveau et voir celle qui se forme dans le cerveau du singe ne nous dit rien de la perception « simiesque » dudit stimulus.
Comment une configuration neuronale fait-elle sens ? De quoi et pour qui est-elle une représentation ? Qui l’interprète ? Comment l’adéquation de la représentation au « réel » est-elle garantie ? Comme le souligne D. Dennett « rien n’est intrinsèquement une représentation de quoi que ce soit ; quelque chose est une représentation seulement pour ou de quelqu’un ; ainsi n’importe quelle représentation ou système de représentation requiert au moins un utilisateur et un interprète externe à cette représentation [] Un tel interprète est alors une sorte d’homoncule. Il s’ensuit qu’une psychologie sans homoncule est impossible tandis qu’une psychologie avec homoncule est condamnée à une régression circulaire ou infinie, ainsi, la psychologie est impossible ». C’est du signifié que le signe reçoit son importance. Aucun objet, dégagé de la relation sémantique triangulaire, n’est jamais par lui-même un signe, ni naturel ni artificiel.
Nous sommes bien obligés, en effet, de nous arrêter à un moment ou à un autre de décrire des processus physiques d’interaction entre les neurones et dire que telle détermination vaut comme résultat pour quelqu’un. Paul Ricoeur distingue l’inventaire des causes qui n’a pas de terme assignable et la recherche des « responsables » qui a pour terme une personne, désignée par un nom propre. De fait, tous les usages courants du terme conscience impliquent une clause limitative indexée par un nom propre ou un pronom personnel.
On peut, certes, répéter de façon quasi-incantatoire que les images apparaissent « comme ça » dans le cerveau et conclure que (on ne sait comment) « En fin de compte, les cartes neurales deviennent des images mentales ». Mais c’est bien cet « en fin de compte » qui fait problème. Quelle qu’en soit la forme, la question de savoir comment le sens vient aux symboles reste sans réponse (comment on passe d’une configuration neuronale objective à une représentation mentale subjective indépendamment du type de couplage supposé entre l’objet et la configuration neuronale associée).
Certains postulent, en effet, l’existence d’un « méta-niveau inviolable » qui peut prendre la forme d’un « module superviseur », d’un « système de fixation des croyances » (Fodor) ou encore d’un « générateur d’hypothèses » (Gazzaniga), tous plus ou moins « cognitivement impénétrables » (Pylyshyn). Mais alors, ou bien une telle instance est de nature différente de toutes les autres et on sort du paradigme physicaliste neuro-cognitiviste, ou bien elle est de même nature (elle traite de l’information) et il ne s’agit que d’une représentation d’ordre supérieur qui ne répond pas davantage à la question de l’interprétation. On peut, certes, postuler comme D. Hofstadter, que la signification est intrinsèque à la physique du système (mais on retombe alors dans une forme d’animisme comme nous le verrons plus loin). On peut affirmer, au contraire, avec Cummins qu’un « crédit de sens » est nécessaire à l’origine pour amorcer, en quelque sorte le processus d’interprétation. Certains ajoutent même que ce pseudo-cognitivisme devra se démettre s’il se révèle incapable d’honorer sa dette ! Il est clair, par exemple, pour Fodor que les processus cognitifs centraux ne sont pas modulaires et « c’est – dit-il – une bien mauvaise nouvelle pour les sciences cognitives ». C’est pourquoi, poursuit-il, « il ne faut pas se faire beaucoup d’illusions sur les perspectives d’une neuropsychologie de la pensée ». Quant au crédit de sens dont parle Cummings, on connait bien l’identité du créditeur dans le cas de l’ordinateur mais s’il en va de même pour l’esprit humain, qui lui a fait crédit ? et de quoi au juste lui a-t-on fait crédit ?
L’irréductibilité de la position de sujet
En fait, toutes les théories réductionnistes présupposent à leur insu ce qu’elles prétendent éliminer. Dire que le cerveau « pense » procède de l’amalgame de deux discours qui ne cessent d’être corrélés mais qui restent irréductibles l’un à l’autre. Comme le philosophe Paul Ricoeur le fait remarquer à J.P. Changeux « Nous comprenons soit un discours psychologique, soit un discours neurophysiologique mais leur relation fait problème parce que nous n’arrivons pas à inscrire leur lien à l’intérieur de l’un ou l’autre. Nous manquons du discours tiers [ ] C’est avec notre cerveau que nous créons des catégories dans un monde qui n’en possède pas sauf celles déjà crées par l’homme ». Le cerveau, insiste Paul Ricoeur, est le substrat, la condition de la pensée mais il ne pense pas au sens d’une pensée qui se pense. Cependant, tandis que je pense il se passe toujours quelque chose dans mon cerveau. Or, on ne sait pas indiquer à quoi (à quel troisième terme) la conscience phénoménale et les états représentationnels neuronaux font référence.
La matière, le cerveau sont des conditions nécessaires à la révélation de l’esprit, mais un ensemble de conditions nécessaires n’effectue rien. L’effectivité de la conscience suppose un « effecteur », une entité subjective irréductible à l’ensemble des conditions qui la révèle. Comme le souligne le psychophysiologiste américain Herrick « Demander qu’on évalue une expérience subjective de manière scientifique avec les critères auxquels on recours en physique ou en chimie, c’est profondément non scientifique ». Les explications physiologiques ne viendront jamais à bout de notre vécu subjectif bien que « l’expérience subjective demeure un fait réel de l’histoire naturelle ». L’expérience subjective est le produit d’une interaction entre sujet et objet, irréductible à l’un ou à l’autre et dont il n’est possible de rendre compte que d’un point de vue tiers.
Les deux termes apparaissent en effet sous la dépendance d’une cause méta-emprique commune. Troisième terme qui n’est, en soi, ni physique ni psychique mais dont les événement physiques et psychiques sont des « symptômes » ou des « projections ». Il ne s’agit ici ni de relation causale, ni de réduction à l’un ou l’autre terme mais d’un réseau de contraintes réciproques. L’inaccessibilité intrinsèque de la cause commune ou du troisième terme à l’analyse rationnelle témoigne du caractère méta-empirique de ce « tiers » dont « je » procède.
« Je » en tant que Soi n’est peut-être qu’une question de point de vue, mais ce point de vue qui est le mien, je ne l’ai pas choisi (« je » ne l’a pas choisi). « Il y a en dans le moi une sorte de commencement absolu dont l’origine est inexplicable d’un point de vue purement physique. Chacun de nous est, au milieu du monde, un point de vue unique et irremplaçable qui fait de l’univers entier le décor de son moi. L’esprit situe tout par rapport à soi. Mais, et c’est bien là le paradoxe de notre finitude, le même esprit qui situe et (me) pose est lui-même situé sans avoir l’initiative de la situation. Il est posé sans s’être posé lui-même. Je situe tout de mon point de vue mais je n’ai pas choisi ce point de vue qui est justement le mien. Je peux, jusqu’à un certain point, déterminer toute chose mais je ne détermine pas la position contingente à partir de laquelle je détermine ou envisage de déterminer toute chose » (P. Léonard).
Le savoir de la Vie
Pour le philosophe Michel Henry, il convient de « réinsérer le savoir dans le champ de la vie ». Le philosophe dénonce « L’oubli de l’enracinement de la science dans l’humain qui la fonde » (La barbarie,1986). Cet oubli s’origine dans la réduction galiléenne de la nature à des idéalités géométriques. Au-delà des qualités sensibles se découvre l’univers abstrait de l’objectivité mathématique. Ces idéalités ne tiennent justement leur être que de ce « monde sensible, subjectif et relatif dans lequel se déroule notre activité quotidienne » et non l’inverse.
À l’opposé du savoir de la science, le savoir de la vie ne relève nullement d’un voir. La vie se caractérise par une « sensibilité » au sens transcendantal de s’éprouver soi-même, « auto révélation » avec laquelle commence et finit la vie. On ne peut accéder au savoir du contenu d’un livre de biologie qu’en sachant mouvoir les mains pour tourner les pages du livre. Selon Michel Henry, la vie exclut de soi toute extériorité. Elle est pure subjectivité, pure épreuve de soi et son savoir réside dans le pathos de cette épreuve qui est justement le savoir de la vie. La sensibilité est la « condition inaperçue » de la science elle-même.
C’est donc bien au prix d’une simplification abusive qu’on en vient à opposer massivement dalisme spiritualiste et monisme matérialiste. Les discours tenus d’un côté et de l’autre relèvent de deux perspectives hétérogènes, c’est-à-dire non réductibles l’une à l’autre et non dérivables l’une de l’autre. Il paraît légitime de défendre un dualisme sémantique exprimant une dualité de perspective, un dualisme des référents et non de substances, comme le suggère P. Ricoeur. Le mental vécu implique le corporel irréductible au corps objectif des sciences de la nature. Le corps, cet objet qui est mien en même temps qu’il est moi. Je « sais » ma taille en même temps que je « suis » ma taille. Corps-objet et corps-vécu ou corps-propre. Le corps figure deux fois dans le discours, comme objet du monde et comme lieu d’où j’appréhende le monde Or, il n’y a pas de passage d’un discours à l’autre. « Ou bien je parle des neurones ou bien je parle de pensée que je relie à mon corps avec lequel je suis dans un rapport de possession et d’appartenance réciproques : mes pieds ou mes mains ne sont miens que vécus comme tels » (P. Ricoeur). En revanche aucun vécu ne correspond à mon cerveau. Je prends avec mes mains n’est pas identique à je pense avec mon cerveau. Le cortex ne sera jamais dans le discours du corps propre. Comme nous l’avons déjà dit avec Damasio, mes connaissances sur le cerveau ne change en rien l’expérience de mon corps vécu.
Michel Henry développe une « théorie du corps subjectif » : je n’ai pas un corps, je suis mon corps, c’est-à-dire « l’ensemble des pouvoirs dont dispose ma subjectivité vivante ». Le problème de l’union de l’âme et du corps tout comme le dilemme idéalisme / matérialisme sont dépassés par cette analyse d’une expérience unitaire affective en laquelle se trouve résolu effectivement toute opposition entre moi-même et le monde qui, résistant à mon effort, se révèle ainsi en lui et par lui (Philosophie et phénoménologie du corps,1965).
Ainsi, nous comprenons soit un discours « psy » soit un discours « neuro » mais leur relation fait problème parce que nous n’arrivons pas à inscrire leur lien à l’intérieur de l’un ou l’autre. Nous manquons du discours tiers « ni-ni ». C’est le même corps-cerveau-esprit qui est vécu et connu, c’est le même homme qui est corporel et mental, mais d’un point de vue que je ne sais pas, un point de vue tiers englobant l’unité de substance. Comme Paul Ricoeur, on ne peut être que sceptique quant à la possibilité de tenir un tel discours de surplomb.
L’hypothèse d’un troisième terme ni-ni (et-et) dont le cerveau et l’esprit serait deux aspects complémentaires (mais pas nécessairement « parallèles ») s’impose finalement à nous. L’esprit – et a fortiori « l’Esprit » – comme fondement absolu ne peut pas être un élément de la série des phénomènes liés par la nécessité. Le fondement n’obéit à aucune nécessité, il est de l’ordre du don et de la gratuité. Dans ce cas, nous ne pouvons que nous recevoir d’un autre et donc l’humain en l’homme n’est pas seulement un produit de la nature. Comme le dit Bergson « Pour atteindre l’homme, il faut viser plus haut que l’homme ». Si l’information « anime » la matière (et suffit à la vie biologique), l’esprit « anime » l’homme qui donc n’est réductible ni à la matière – énergie, ni à l’information, mais suppose un « plus » qui n’est pas de l’ordre de la nécessité mais, répétons-le, de l’ordre du « don ». L’information est (par définition) quantifiable et, même si elle n’est « ni matière, ni énergie » (N. Wiener), elle implique un « coût » (qui a même été formellement calculé par Brillouin) alors que l’esprit n’est pas quantifiable et qu’il ne « coûte » rien. L’esprit ne se partage pas comme un gâteau : non seulement son partage est sans réduction mais il est au contraire amplifiant.
Éloge de l’incomplétude
La pensée, l’esprit, le sujet, ne sauraient être objectivement circonscrits et donc leur présence n’est pas à rechercher dans ou à côté des processus, mais dans l’impossibilité pour les processus de s’autojustifier. Loin de constituer un échec de la raison, l’incomplétude du sujet empirique désigne un espace offert, au cœur de la rationalité, à la révélation d’un sens.
Aux notions classiques de causalité linéaire, réduction, intelligibilité complète, maîtrise, stabilité, prévisibilité, font désormais place (comme nous le soulignions au début de cette réflexion) celles de sensibilité aux conditions initiales, irréductibilité, incomplétude, incertitude, instabilité, imprédictibilité. Comme nous l’avons déjà dit, l’émergence, au sein même de la rationalité scientifique, de telles notions traduit le fait que la science ne peut administrer la démonstration de ses propres convictions. Il s’agit de prendre toute la mesure de la positivité de cette incertitude qui apparaît comme la condition même de la connaissance. Une telle limitation témoigne, non d’une insuffisance intrinsèque du Réel, mais d’un manque constitutif du sujet connaissant, d’une absence fondatrice.
De la physique à la psychanalyse : quelque-chose « résiste »
![]() Wittgenstein et l’indicible
Wittgenstein et l’indicible
La prétention à la complétude du discours scientifique, qui va de pair avec la revendication de certitude, suppose l’existence d’un langage susceptible de refléter la totalité du réel. Or, il ressort de l’oeuvre de Wittgenstein que la structure logique du langage ne peut être décrite à l’intérieur du langage lui-même. Autrement dit, ce dans quoi ou grâce à quoi on représente, n’est pas représentable (est inexprimable). Le sens se montre dans la structure même de l’énoncé mais ne se dit pas. Il y a donc de l’inexprimable au-delà du langage. Qu’il y ait de l’indicible, c’est finalement la condition pour qu’il y ait du sens.
![]() Gödel et l’indécidable
Gödel et l’indécidable
Le langage ne peut pas refléter adéquatement la totalité. Pourtant, la science classique – avec son rêve de prévisibilité parfaite – affirme sa volonté de construire un système de représentation exhaustif. Mais pour constituer une tel système formel il faudrait pouvoir démontrer sa cohérence (sa consistance) de manière absolue, sans avoir à présupposer la cohérence (la consistance) d’aucun autre système. Pour éviter le piège de la régression infinie des énoncés justificateurs et celui des fausses évidences de l’expérience sensible, il faudrait donc pouvoir démontrer que la logique est complète et non contradictoire sans avoir recours à d’autres ressources que les siennes propres, c’est-à-dire qu’elle se suffit à elle-même. La tentative la plus élaborée fut celle de Hilbert qui prétendait pouvoir démontrer la consistance absolue de la logique de manière purement formelle. Or, les travaux de Gödel sont venus mettre un terme aux prétentions du programme de Hilbert et ruiner définitivement tout espoir de démonstration de la consistance absolue de la logique. Les résultats de Gödel indiquent, en substance, qu’il est logiquement impossible de donner une démonstration méta-mathématique de la consistance de l’arithmétique et qu’il existe donc des propositions arithmétiques vraies qu’on ne peut pas déduire des axiomes. Autrement dit il existe des énoncés vrais non démontrables. Il s’ensuit qu’aucune théorie ne peut apporter par elle-même la preuve de sa propre consistance et que l’auto-description complète est logiquement impossible. La consistance implique l’incomplétude et la complétude ne peut être obtenue qu’aux dépens de la consistance. La logique ne se contient pas. Si le monde est réductible à un calcul, il est ultimement inaccessible et cette inaccessibilité est la condition même de sa calculabilité.
![]() Heisenberg et l’indétermination
Heisenberg et l’indétermination
La physique quantique constitue, on le sait, une remise en cause radicale de notre conception de l’univers associée à un changement, non moins radical, du statut de l’observateur. La réalité décrite par la physique n’est plus indépendante des modalités de la description. L’observation suppose la participation d’un observateur et implique une interaction avec l’objet observé. Mesurer c’est agir sur le réel ou plutôt interagir avec lui. Une telle interaction perturbe nécessairement l’objet et il s’ensuit que toute mesure est entachée d’une irréductible indétermination exprimée, dans le formalisme de la physique quantique, par la célèbre relation d’incertitude (d’indétermination) de Heisenberg. L’incertain apparaît ici co-extensif – sinon du Réel – du moins de la connaissance que nous pouvons en avoir. Il est impossible – au niveau micro-physique – d’attribuer à une particule, simultanément et avec la même précision, une position et une vitesse (quantité de mouvement) déterminées. La précision sur la vitesse est inversement proportionnelle à la précision sur la position et le produit des incertitudes ne peut pas être inférieur à une valeur fixée par la relation de Heisenberg. Il y a donc une limite absolue – un butoir – à la connaissance de l’objet quantique.
![]() Lacan et l’incomplétude
Lacan et l’incomplétude
Il est tout à fait remarquable de constater que Lacan se situe dans la même logique que les trois auteurs précédents : celle de l’incomplétude. Le sujet, selon Lacan, est un sujet divisé, un sujet barré. Précédé par le langage il ne peut se structurer qu’autour d’un manque. On est toujours obligé de présupposer quelque chose dont on n’est pas le maître. Quelque chose échappe – qui est de l’ordre de l’origine – et c’est pourquoi il convient de n’enfermer le sujet dans aucune forme d’objectivation. On n’a pas prise sur le sujet. Il y a là quelque chose d’irreprésentable. Il n’y a pas de signifiant qui se signifierait lui-même. Avec la division originelle du sujet on retrouve le même type d’alternative que chez Gödel ou Heisenberg. On ne peut pas ne pas choisir, puisqu’on ne peut pas à la fois penser et être, et ce que l’on gagne d’un côté on le perd de l’autre. Quoi qu’on choisisse, on perd quelque chose.
Une absence qui fait signe
Il apparaît désormais à l’évidence que tant l’étude du langage (Wittgenstein) ou celle de la logique (Gödel) que celle de la structure de la matière (Heisenberg) ou de l’inconscient (Lacan), débouchent sur le même constat d’incomplétude, le même horizon d’indécidabilité, la même impossibilité à limiter le vrai à la totalité de ce qui peut être dit, formellement démontré ou immédiatement mesuré. La question de l’implication nécessaire, mais non-déterminante, du biologique dans le psychologique trouve ici un nouvel éclairage. Ainsi, il n’y a pas lieu de chercher où et comment l’esprit agit sur le cerveau. Les effets physico-chimiques ont des causes physico-chimiques mais ces causes ne se contiennent pas ; elles expriment une causalité qui les transcende.
La notion de cause est particulièrement ambiguë dans le discours scientifique. En science le mot cause est généralement employé dans le sens de cause occasionnelle. Or, celle-ci ne peut que fournir à une causalité donnée l’occasion d’exercer une action. En ce sens elle n’est la cause de rien mais seulement la condition de l’effet produit par ladite causalité. La causalité désigne ici un principe causal qui s’actualise dans des causes au sens scientifique habituel du terme, causes avec lesquelles ce principe ne doit pas être confondu et auxquelles il ne se réduit pas. La science appelle donc cause ce qui est en fait la condition du phénomène observé.
Ainsi, l’esprit ne cause pas, au sens physique habituel du terme, le fonctionnement des neurones, mais s’identifie à la causalité qui s’exprime dans ce fonctionnement. Inversement, le cerveau conditionne la pensée, on peut même dire qu’il la façonne, mais ne la cause pas. La causalité n’est pas représentable, elle se montre dans les causes (« occasionnelles »). Le cerveau est la condition, l’occasion offerte à la causalité, qu’on identifiera ici à l’esprit, d’exercer son action. Il est (le cerveau) en quelque sorte, le « révélateur » de l’esprit. Par sa condition, le sujet manifeste sa propre transcendance mais ne peut l’exprimer. Le rapport de la condition (le cerveau) et de l’inconditionné (l’esprit) constitutif du sujet n’est pas représentable : il ne peut être que vécu. Ainsi, l’intériorité du sujet ne peut se manifester dans le monde objectif que sur le mode de l’absence, comme une sorte d’exception non figurable, d’angle mort de la connaissance, de tache aveugle de la représentation. Le cerveau apparaît alors comme « la face visible de l’esprit » et non l’esprit comme la face invisible du cerveau.
Comme c’est aux marges du langage que se montre le sens (ce que Wittgenstein appelle l’élément mystique), c’est seulement aux marges de la description neurophysiologique que peut se montrer celui qui dit je. Le procès du sens, du sujet, de l’esprit, ne peut se solder, du point de vue empirique, que par un non-lieu. Il n’y a pas lieu, en effet, de continuer à chercher la représentation de ce qui n’est pas représentable et qui donc ne saurait être circonscrit en quelque lieu que ce soit. Mais il y a lieu de lui faire une place.
L’esprit comme fondement-effacement
L’esprit du fait même de son caractère fondateur échappe forcément à toute tentative de représentation. L’esprit apparaît ici en position de « conjecture initiale ». Il désigne ce que je dois d’emblée admettre pour que la connaissance (de l’homme) soit possible. L’esprit en tant que fondement ne laisse évidemment pas de trace dans le système (sinon celle de son effacement) mais se montre en acte. C’est donc seulement « en creux », sur le mode de l’absence, que peut se laisser appréhender le fondement dont on pourra toujours nier l’existence en tant que trace mais qui est attesté par le fait même de son effectivité. Il en va bien ainsi de la science qui entend se livrer à l’étude du réel seulement sur la base de traces objectives constituées en système cohérent. De ce fait tout ce qui est transcendant à ce système ne saurait y être représenté. Comme il ne faut pas s’étonner du silence de Dieu dans la nature il faut prendre son parti du silence de l’esprit dans le cerveau. La réduction s’accomplit dans ce qu’elle efface.
Ainsi, le fondement n’est pas représentable puisque, du point de vue empirique seul accessible à la science, il ne laisse de trace que celle de son absence. Les dons « en nature » n’apparaissent pas au bilan. Marvin Minsky peut alors légitimement supposer que « C’est peut-être justement parce qu’il n’y a personne dans notre tête pour nous faire faire ce que nous voulons, ni même nous faire vouloir vouloir, que nous créons le mythe selon lequel nous sommes à l’intérieur de nous-même ». Mais une telle proposition est auto-contradictoire car, si nous nous trompons effectivement, alors qui (ou que) trompons-nous ? Le sujet se révèle ainsi toujours « à la limite », de la régression comme de la représentation. Or la limite, au sens de fondation, ne se trouve jamais attestée dans l’usage : celui-ci demeure tel que l’on puisse toujours remonter d’une étape au moins. Et, de plus, la limite est un non- lieu.
Comme une icône ne représente pas ce qu’elle signifie, elle le montre, le tableau de la science ne contient évidemment pas, sinon sur le mode de l’absence, ce qu’il manifeste. Une telle présence dans l’absence n’est pas du domaine de la preuve mais de l’épreuve c’est-à-dire à la fois de ce qui s’éprouve, de ce dont on fait soi-même l’expérience, et de ce par quoi on est affecté. C’est précisément dans l’absence (de preuves) que s’éprouve la présence à soi de celui qui dit « je ».
Dans la mesure où la science objective exclut délibérément, par une axiomatique adaptée à son propos, le sujet axiologique (la liberté, le sens) de son champ d’investigation, elle ne saurait ni le rencontrer, ni l’exclure : ce n’est pas de sa compétence. Nos opinions et nos croyances ne se fondent pas – et ne peuvent pas se fonder – sur une base exclusivement logique. La logique n’a pas de sens en elle-même et son fondement – tout comme la source du sens – lui échappe (Godel). C’est pourquoi l’axiomatique scientifique est incapable de répondre à la question posée par l’existence d’un sujet axiologique revendiquant une éthique. Un humanisme fondé exclusivement sur la rationalité scientifique ne peut être que dérisoire. Dégagé de tout impératif catégorique, la loi morale est seulement le reflet d’un consensus précaire. La négation du sujet métaphysique – ou sa réduction physicaliste – conduisent nécessairement à la négation de quelqu’absolu en l’homme et ouvre la voie à toutes les aventures, comme l’histoire de ce siècle n’a pas manqué de nous le rappeler.
On ne saurait accéder à une véritable objectivité en niant notre subjectivité. On ne recompose pas quelqu’un, un soi, un sujet de l’extérieur, en son absence. Multiplier ou augmenter les éclairages n’augmente guère les chances de retrouver les clés perdues ailleurs. Reconnaître l’existence d’une instance irréductible à ses manifestations objectives n’a rien de dérisoire « car ce n’est pas une échappatoire que d’exprimer avec des mots anciens et quelque peu philosophiques les deux bouts d’une chaîne qu’il faut désespérément tenir l’un et l’autre » (P. Costabel).
L’incontournable question du sujet
Comme l’affirme Claude Bernard « On ne ramènera jamais les manifestations de notre âme aux propriétés brutes des appareils nerveux pas plus qu’on ne comprendra de suaves mélodies par les seules propriétés du bois ou des cordes du violon nécessaires pour les exprimer ». Dans l’ordre de la causalité, il existe un rapport direct et de même nature entre l’antécédent et le conséquent (l’abus d’alcool cause l’ivresse). Dans l’ordre du conditionnement, au contraire, le résultat déborde la condition qui l’a rendu possible : l’art de Rostropovitch ne se ramène pas à la qualité de son violoncelle, tout en dépendant de lui.
Un sujet personnel se manifeste irréductiblement au delà de tout traitement de l’information, autrement dit de toute forme d’objectivation, par le fait même que c’est lui qui objective. En objectivant le monde quelqu’un s’objective paradoxalement comme inobjectivable. Les processus neuronaux fonctionnellement nécessaires à la conscience et à la pensée impliquent l’existence d’un co-principe qui ne peut qu’échapper à l’observation empiriquement objectivante. L’esprit n’est pas de l’ordre de la quantité : ce qui permet de quantifier n’est pas quantifiable.
La question essentielle reste bien celle du « je » (de celui pour qui le monde fait sens). Comme le souligne P. Lévy « l’explication mécaniste s’arrête devant l’unité non fonctionnelle du sujet pensant et cette difficulté ne tient ni à des préjugés religieux ni à des raisons théologiques […] L’explication mécaniste s’arrête devant l’unité non-fonctionnelle du sujet pensant et cette difficulté ne tient ni à des préjugés religieux ni à des raisons théologiques […] Qui -poursuit Lévy – voit donc trembler dans la lumière la poudre d’or du mimosa ? Ce ne sera ni cette machine (le cerveau) ni une autre, mais quelque chose d’autre qu’une machine […] Pourra-t-on désigner scientifiquement celui qui perçoit, celui pour qui le monde existe ? Nous pouvons décrire exactement la manière dont le flux photonique tombe des étoiles, on ne sait toujours pas comment la lumière jaillit du regard ».
Repères bibliographiques
Andler D. (1986). Les sciences de la cognition. In Hamburger, J. (dir.) La philosophie des sciences aujourd’hui, Gauthier-Villars / Bordas, Paris.
Assoun, P.L., (1995). Freud, la philosophie et les philosophes. Quadrige, PUF, Paris.
Bernard, J. (1987). Et L’Ame… ? demande Brigitte. Buchet-Chastel, Paris.
Bricmont, J. (2005). Préface. In Sokal, A. Pseudosciences et postmodernisme. Odile Jacob, Paris.
Bunge, M. (1980). The Mind-Body Problem. A Psychological Approch. Pergarnon Press, Oxford.
Changeux J.P. (1983). L’Homme Neuronal. Fayard, Paris.
Changeux J-P. et Connes, A. (1989). Matière à pensée. Odile Jacob, Paris.
Changeux, J.P. et Ricoeur, P. (1998). La nature et la règle. Odile Jacob, Paris.
Costabel, P. (1983). Les notions de corps et de soi à la fin du xx° siècle. Soi et non soi, Seuil, Paris.
Cummings, A.R. (1983). The Nature of Psychological Explanation. Bradford Books / MIT Press.
Damasio, A.R. (1995). L’erreur de Descartes. La raison des émotions. Odile Jacob, Paris
Damasio, A.R. (1999). Le sentiment même de soi. Corps, émotions, conscience. Odile Jacob, Paris.
Dennett, D.C. (1978). Brainstorn. Bradford Books & Harvester Press.
Dennett, D.C. (1993). La conscience expliquée. Odile Jacob, Paris.
Dreyfus, H.L. (1984). Intelligence artificielle : mythes et limiles. Flammarion.
Dufour-Kowalska, G. (2003). Michel Henry. Passion et magnificence de la vie. Beauchesne, Paris
Eccles, J.C. (1981). Le Mystère Humain. Mardaga, Bruxelles.
Eccles, J.C. (1992). Evolution du cerveau et création de la conscience. A la recherche de la vraie nature de l’homme. Fayard, Paris.
Eccles, J.C. (1997). Comment la conscience contrôle le cerveau. Fayard, Paris.
Edelman G.M. (1994). Biologie de la Conscience. Odile Jacob, Paris.
Fodor, J.A. (1986). La modularité de l’esprit, essai sur la psychologie des faculté. Editions de Minuit, Paris.
Gazzaniga, M. (1987). Le cerveau social. Robert Laffont, Paris.
Hofstadter, D. et Dennett, D. (1987). Vues de l’Esprit. InterEditions, Paris.
Lacan, J. (1966). Ecrits. Seuil, Paris.
Ladrière, J. (1982). Wittgenstein et la philosophie analytique. Science et foi, Desclée International, Paris.
Lambert, J.F. (1992). L’épreuve du sens. Science et incomplétude. Les Cahiers Jean Scot Erigène, volume 3, Guy Trédaniel Editeur, Paris.
Lambert, J-F. (1993). Les sciences cognitives à l’épreuve de la théologie. Colloque Science et Gnose, ARIES n°XVII.
Lambert J-F. (1991). Singularité de la nature du cerveau humain. Systèmes naturels, systèmes artificiels. Champ Vallon.
Léonard, P. (1987). Les raisons de croire. Fayard-Communio.
Lévy, P. (1987). La machine univers. Création, cognition et culture informatique. Editions la Découverte, Paris.
Libet, B. (1992). The Neural Time. Factor in Perception, Volition and Free Will. Revue de Métaphysique et de Morale, N°2, pp 255-272.
Lorenz, K et Popper, K. (1990). L’avenir est ouvert. Flammarion, Paris.
Malherbe, J.F. (1981). Epistémologies anglo-saxonnes. P.U.F., Paris.
Malherbe, J.F. (1985). Le langage théologique à l’âge de la science. Editions du Cerf, Paris.
Minsky, M. (1988). La Société de l’Esprit. InterEditions, Paris.
Popper, K. et Eccles, J.C. (1977). The Self and its Brain. Springer-Verlag.
Popper K. (1973). La logique de la découverte scientifique. Payot, Paris.
Popper, K. (1984). L’univers irrésolu. Hermann, Paris.
Pylyshyn, Z.W. (1984). Computation and cognition. Bradford Books / MIT Press.
Schiller, J. (1967). Claude Bernard et les problèmes scientifiques de son temps. Ed. du Cèdre
Searle, J.R. (1985). Du cerveau au savoir. Hermann, Paris.
Searle, J.R. (1999). Le mystère de la conscience. Odile Jacob, Paris.
Valenta, A. (1995). Le scientisme ou l’incroyable séduction d’une doctrine erronée. Auto Edition.
Wittgenstein, L. (1961). Tractatus logico-philosophicus et Investigations philosophiques. Gallimard, Paris.
Wittgenstein, L. (1992). Conversation sur Freud et Conférence sur l’Ethique. Leçons et conversations Gallimard, Paris.
ÉCHANGE DE VUES
Philippe Laburthe-Tolra :
Comme j’ai été doyen de faculté de sciences sociales, je vous ai très bien suivi. Notamment votre distinction entre le sujet et l’objet, ainsi que l’importance de souligner la différence entre expliquer et comprendre.
Vous avez abordé en final ce que j’attendais : le point sur l’état des choses actuellement.
Je pense que parmi les jeunes collègues que je continue de fréquenter dans un laboratoire du CNRS, il y a quand même l’irruption de nouvelles données épistémologiques – vous l’avez dit, mais vous ne l’avez pas développé. – Je trouve quant à moi très intéressant qu’à l’intérieur même de la science surgisse un principe d’imprédictabilité, depuis le principe d’incertitude de Heisenberg qui reposait sur la constatation que les géométries non-euclidiennes ont leur logique, et que cette logique fournit des explications dans les domaines de l’infiniment petit comme de l’infiniment grand.
On s’aperçoit alors que la manière newtonienne de raisonner en terme de cause-conséquence, (selon le principe « rien n’est sans raison » de Leibniz), on s’aperçoit que cette causalité univoque, ce principe du déterminisme, ne répond plus à rien finalement. Par contre, dans la théorie du fractal, dans les réseaux de théories actuelles, on apprend à penser globalement et plus modestement. La place peut être faite à la liberté et au mystère. Un exemple très simple que m’en a été donné par l’un de mes collègues l’autre jour. La formule chimique du sel de cuisine, c’est celle du chlorure de sodium : ClNa. Or le chlore est toxique pour l’homme, et le sodium est caustique, soude caustique. Comment se fait-il que la combinaison de ces deux produits mortels constituent quelque chose de tout à fait étrange qui conserve la matière vivante et lui est indispensable ? N’y -t-il pas là un mystère implicite à la formule ?
Voilà ce que je me permets d’ajouter pour la défense des sciences humaines.
Jean-François Lambert :
Il ne s’agit pas de jeter le bébé avec l’eau du bain et, heureusement, à l’intérieur du champ des SHS tout le monde n’est pas sur la ligne dure que j’ai décrite. Mais cette ligne dure existe même si elle est moins présente chez les « praticiens ordinaires » que chez les philosophes, chez ceux qui prétendent théoriser sur l’activité scientifique de base.
Je voudrais revenir sur les couples « expliquer et comprendre » et « cause et raison ». Wittgenstein insiste particulièrement sur cette distinction à propos de la critique qu’il fait de la psychanalyse : pour lui, Freud confond cause et raison. Que vient-on chercher en psychothérapie sinon des raisons de vivre avec sa névrose. Prenez l’exemple de la maman dont la fille adolescente est anorexique, et n’a plus ses règles. Donc on va chez le psychothérapeute. Et le psy (très bien formé en neurosciences !) va expliquer à la dame que, chez sa fille, certains neurones de l’hypothalamus étant défaillants, le déficit en libérines qui s’ensuit entraîne un ralentissement de la production de stimulines par l’hypophyse antérieure et finalement un défaut de folliculine qui aboutit au blocage le cycle ovarien. Voilà une explication des symptômes de cette adolescente mais est-ce bien cela qu’on attend d’un psychothérapeute ? On n’y vient pas pour entendre une explication causale mais pour trouver des raisons, quelles qu’elles soient, dans son enfance ou dans son environnement actuel, des motifs qui vont donner sens aux symptômes. Les raisons sont de l’ordre de la compréhension alors que la causalité est de l’ordre de l’explication.
Père Jean-Christophe Chauvin :
La science et le progrès prennent, aujourd’hui, l’homme comme objet et le réduisent.
Ce discours-là, je l’ai entendu aussi en faisant de la théologie. L’objet de la théologie, c’est Dieu et quand on le prend comme cela, on le réduit aussi. Et c’est tout le problème de la théologie qui se veut scientifique et qui finit par tuer Dieu, comme votre citation de départ tuait l’homme.
Seulement, la théologie est quand même obligée de se dire : nous voudrions une connaissance vraie de Dieu et donc, l’on repart. On essaie de prendre la parole de Dieu telle qu’elle est et l’interpréter, etc.
Vous avez dit : il y a la science telle qu’on l’entend aujourd’hui et elle ne vise pas la connaissance que l’on a de l’homme.
Ma question est de savoir : dans cette connaissance que l’on a de l’homme, réelle malgré tout même si elle n’est pas scientifique au sens strict du terme, tout homme cherche non seulement des causes mais des raisons, cherche non seulement à expliquer mais à comprendre. Y a-t-il aujourd’hui des hommes qui cherchent à travailler cette connaissance, peut-être pas au sens scientifique strict du terme, mais d’apporter des raisons, de chercher des causes, de travailler ce mode de connaissance qui n’est pas strictement scientifique ?
Jean-François Lambert :
Je ne peux que renvoyer à la citation de Popper et insister sur le fait que même la connaissance scientifique la plus rigoureuse a un amont, suppose des préalables. Beaucoup ne veulent pas le reconnaître, mais il y a forcément des implicites, des conditions initiales qui échappent au discours constitué. Un scientiste, je l’ai déjà dit, c’est « un amnésique des conditions initiales ». C’est quelqu’un qui fait comme si son savoir tenait tout seul, comme si on pouvait s’élever en tirant sur les lacets de ses propres chaussures. Le scientiste me fait penser à cet ivrogne qui cherche ses clés perdues ailleurs sous le cône de lumière d’un réverbère sous prétexte que là c’est éclairé. Entendons-nous bien. Je suis de ceux qui pensent que la zone éclairée par la science s’élargit sans cesse et va continuer de s’élargir et que personne ne peut définir précisément ses limites. Mais il y a un au-delà du discours éclairé par la science. Le problème reste bien celui de la démarcation (entre la zone éclairée par la science et le reste du savoir ou entre science et métaphysique). La même erreur de démarcation est commise par Jean-Pierre Changeux quand il dit ne pas voir d’esprit dans les neurones (moi non plus… et heureusement !) que par Sir John Eccles quand il prétend montrer, grâce à la mécanique quantique, comment l’esprit vient chatouiller les synapses. C’est la même erreur que de vouloir appliquer les techniques valables dans la zone éclairée à la zone non éclairée. La même erreur est commise par ceux qui prétendent qu’au-delà de la zone éclairée il n’y a rien parce que ce qui n’est pas éclairé n’existe pas et par ceux qui prétendent explorer la zone non éclairée avec les mêmes outils que la zone éclairée.
Père Jean-Christophe Chauvin :
Est-ce que l’on a des outils pour aller chercher dans la zone non éclairée ?
Jean-François Lambert :
Reprenons le couple « preuve-épreuve ». Pour moi, il n’y a pas (il ne saurait y avoir) de preuve (au sens scientifique du terme) de l’existence de Dieu, mais « j’éprouve » l’existence de Dieu en ce sens que j’en fais l’expérience (vécue) en même temps que je suis « éprouvé » (affecté) par cette expérience (cette épreuve). Le grand intérêt d’un philosophe comme Michel Henry, c’est précisément de parler de la vie comme d’un donné qui ne se décrit pas mais qui s’éprouve. Les meilleurs outils pour explorer la zone non éclairée sont en nous .
Rémi Sentis :
Je souscris entièrement à ce que vous dites, je voulais seulement introduire une idée semblable.
Quand on décrit le darwinisme actuel, du XXIe siècle, comme une continuité absolue entre l’homme et l’animal, il n’y a alors plus de raison de se prévaloir du parrainage du darwinisme parce que Darwin lui-même disait qu’il y avait une distinction très nette entre l’homme et l’animal, et que seul l’homme était capable d’un raisonnement moral.
Sur la question du fonctionnement du raisonnement humain et quand on parle d’intelligence artificielle, il y a une chose qui, peut-être, n’a pas été assez soulignée, c’est que jamais un ordinateur n’arrivera à énoncer un théorème. Jamais. Parce que, quand on énonce un théorème mathématique, il faut inventer les hypothèses. Il faut deviner quelles sont les hypothèses qui permettront d’établir le théorème. Deviner, un ordinateur ne pourra jamais le faire.
Jean-François Lambert :
J’aurais dû parler de néodarwinisme plutôt que de Darwin lui-même. Pour ce qui est des ordinateurs, vous vous souvenez peut-être du fameux bouquin de Dreyfus L’intelligence artificielle, mythe et réalité dans lequel Dreyfus défend que : Si les robots ne peuvent pas penser, ce n’est pas parce qu’ils n’ont pas d’âme, mais parce qu’ils n’ont pas de corps. Autrement dit, parce qu’ils ne sont pas « affectés » par les opérations qu’ils réalisent. L’affect, c’est à la fois les affects, les sentiments, et ce qui m’affecte (m’éprouve). Je ferai encore une fois référence à Michel Henry : la Vie, c’est précisément ce qui m’affecte. Je ne peux que l’éprouver. Je la prouve en l’éprouvant. Je ne peux jamais prouver ce que je ressens, je ne peux précisément que l’éprouver.
Catherine Rouvier :
D’abord une remarque. Je voudrais vous remercier infiniment parce que je suis juriste, j’enseigne les sciences sociales et nous subissons en droit la tyrannie de la science de la même manière. Je suis émerveillée de voir le scientifique pur que vous êtes relativiser ce qu’on nous répète sans arrêt, depuis Auguste Comte : les faits, pas la théorie, les faits. Ce n’est pas la théorie contre les faits, vous l’avez très bien dit, et la subjectivité s’en mêle.Vous avez remarquablement démontré qu’on est en train de détruire l’homme, enfin, on essaie le plus possible et on est en train de détruire le droit de la même manière et par le même processus ; ce qu’on appelle ‘‘théorie du droit’’ aujourd’hui, c’est trop souvent cela. Une entreprise de démolition, qui réduit le droit à un contenant, à la seule légitimité procédurale, externe en évacuant le contenu, donc le sens. Vous parliez du nerf optique et du point aveugle…. On a l’impression que ce faisant on coupe le nerf optique. On ne sait pas très bien ce qui va rester : le point aveugle de la rétine ?
Ensuite une question à propos de ce que vous avez dit sur la distinction ‘‘doxa, épistémè, Logos’’. Saint Paul, au 1er siècle, écrit que l’Esprit de Dieu est une sagesse cachée dont la connaissance ne peut se faire qu’en crucifiant sa propre chair, c’est-à-dire en participant, en communiant au sacrifice du Christ. Saint Thomas, au XIIIème siècle, réaffirme que la pensée ne se limite pas à ce qui est produit par le cerveau. Or vous nous avez dit que vous en étiez persuadé également. Et c’est un point capital car il touche à la possibilité, d’une « âme » ou non, distincte du corps et qui peut donc lui survivre. Avec quels mots d’aujourd’hui, et pas trop scientifiques pourrait-on le dire ?
Jean-François Lambert :
Puisque vous faites référence à Saint Paul, vous savez que dans la première épître aux Corinthiens (1 Cor. 2,14) il est dit que le couple corps-âme ne conduirait qu’à « l’homme psychique », incapable d’accueillir l’Esprit de Dieu, homme psychique que Saint-Paul oppose, pour cette raison, à « l’homme spirituel ». On retrouve cette conception tripartite de la personne humaine dans la première épitre aux Thessaloniciens : « Que le Dieu de la paix vous sanctifie totalement, et que votre être entier, l’esprit, l’âme et le corps soient gardés sans reproche à l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ » (1 Th. 5,23). Ainsi, pour un chrétien, l’être entier de l’homme comporte l’esprit, l’âme et le corps car à la dichotomie habituelle âme-corps, commune à tous les êtres vivants l’esprit s’ajoute pour l’homme d’une manière distinctive.
L’information suffit à la vie, l’esprit seul anime l’homme. En termes contemporains corps et âme font bien partie des sciences de la nature, l’âme étant anima au sens aristotélicien. Information, cognition, raisonnement, qui sont l’objet des sciences cognitives, relèvent bien d’une approche naturaliste même si cette « âme » ne se réduit pas à la matérialité du corps physique.
Quant à l’Esprit – au sens spirituel du terme – il ne fait pas nombre avec les deux termes précédents. Certes, Dieu aurait peut-être pu s’économiser un détour de plusieurs milliards d’années d’évolution cosmique et biologique pour arriver à un cerveau capable d’accueillir (ou d’être « infusé par) cet Esprit. Je vois là un double mouvement : celui des sciences naturelles qui coordonne « corps et âme », selon la terminologie de Saint Paul, l’âme n’étant pas ici à proprement parler « surnaturelle » bien que non réductible à l’organique. Elle est, en quelque sorte « entre les deux ». Elle fait partie du champ de ce qu’on peut investiguer par des moyens scientifiques et peut même être considérée comme un produit de l’évolution. Mais il a fallu arriver à un certain niveau d’évolution pour que ce « corps-âme » vécu soit susceptible d’entrer en résonance, d’accueillir l’Esprit. Je ne sais pas trop comment le dire car il ne s’agit pas d’imaginer un « tuner » dans la tête accordé sur la fréquence de Dieu. Il s’agit d’un don et non d’un produit de l’évolution. Nous sommes bien là dans le domaine de la grâce et de la surnature. Il faut rendre aux sciences cognitives ce qui leur appartient et il n’y a pas de raison de s’opposer à l’idée que le calcul mental ou la logique formelle sont des processus naturels.
En revanche, l’Esprit au sens de ce qui m’est donné et qui donne sens à ma vie ne fait pas nombre avec la structure susceptible de l’accueillir. Comme j’ai essayé de le suggérer à la fin de mon exposé « quelque chose résiste » et ce quelque chose, qui précisément n’est pas de l’ordre des choses, fait signe de cette part de moi irréductible à toute description objectivante. La seule façon, selon moi, d’appréhender dans le monde objectif ce qui est de l’ordre de l’esprit, c’est précisément dans le fait que le monde objectif n’est pas complet, dans le fait qu’aucune description objective de ce que je suis ne peut prétendre à la complétude.
Cette ultime réalité n’est perceptible « qu’en creux » et il n’est donc pas étonnant qu’on ne puisse pas montrer « en relief » (positivement) quelque chose qui n’existe qu’en creux, quelque chose qui ne fait pas partie du domaine décrit par les sciences objectives. Certes, cela ne constitue pas une démonstration de l’existence objective de l’esprit qui ne peut que se « montrer » à la marge des phénomènes, comme le sens – selon Wittgenstein – se montre aux marges de la phrase. Les mots ne disent pas le sens, mais le sens se montre à travers eux. Le sens est à la marge du monde objectif et c’est seulement à travers le manque-à-dire, l’incomplétude de ce monde objectif que peut se révéler le mystère de l’être.
Père Gérard Guitton :
Je voudrais prononcer un mot que vous n’avez pas prononcé, c’est l’économie.
Il est certain qu’aujourd’hui nous sommes dominés par les problèmes économiques. Il y a beaucoup d’irrationnel dans la science économique, elle domine même le monde politique.
Alors, je voudrais rappeler un souvenir familial puisque notre père (Henri Guitton) était professeur d’économie. Et dans notre jeunesse, nous nous souvenons très bien que notre père qui enseignait à la faculté de droit a montré et encouragé l’évolution vers une appellation de science humaine, il y a participé. L’économie était d’abord un petit domaine dans les facultés de droit et puis ensuite, elle a pris son autonomie et mon père a beaucoup contribué à faire de l’économie une science et à a montré que la science économique était plus proche des mathématiques, des statistiques, des sciences de l’observation que la science juridique, comme on dit maintenant, puisque le droit n’était pas encore appelé une science.
Aujourd’hui les sciences économiques ont pris leur autonomie, elles ont des facultés totalement détachées du domaine juridique, et c’est heureux. Je tenais à rappeler ce souvenir lié à l’ancien président de l’AES, Henri Guitton.
Jean-François Lambert :
Il y a un fil conducteur, un point commun entre tout ça (les sciences économiques, les sciences juridiques, les sciences cognitives) : c’est la réduction, le formalisme, l’importance excessive accordée à l’information aux dépens de la matière-énergie. La biologie moléculaire, cherche à formaliser la structure du vivant. On essaie, de même, de formaliser complètement le droit. En psychiatrie, le fameux DSM, la bible des psychiatres, permet désormais d’établir un diagnostic à partir d’un codage « mécanique » des symptômes. C’est le même processus de réduction formelle qui est partout à l’oeuvre. C’est le règne de l’abstraction aux dépens souvent du simple bon sens et de la « vraie vie » dont parle Michel Henry. Et le droit n’y échappe pas !
Séance du 11 décembre 2008